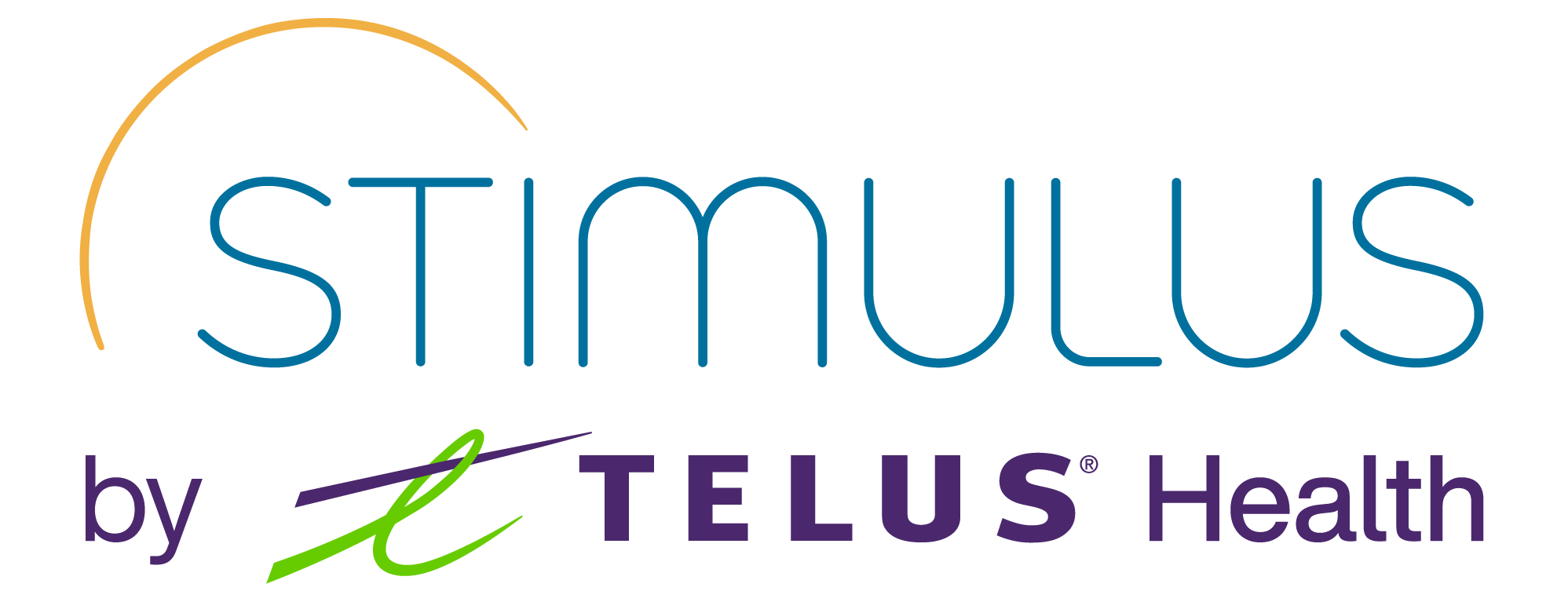Pour en finir avec la courbe du deuil en entreprise
Analyse critique et alternatives modernes.
La courbe de deuil de Kübler-Ross : toujours utilisée en entreprise
Nous sommes toujours surpris lorsque nous intervenons aujourd’hui en entreprise pour aider à l’accompagnement humain des changements et des transformations, que l’on nous parle encore et toujours de la courbe de deuil de Kübler-Ross. Extraite de son livre « On Death and Dying », de 1969, cette courbe est initialement développée pour évoquer des étapes du deuil, mais est depuis utilisée pour modéliser cinq étapes chronologiques qui décrivent les réactions psychologiques et émotionnelles qu’un individu aurait face à un changement organisationnel : le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l’acceptation. Nous ne rentrerons pas dans l’explication de ces différentes phases qui sont d’ailleurs, par leurs titres, sont assez clairs.
Une modélisation rassurante mais figée.
Pourquoi un tel modèle résiste à l’œuvre du temps pour que 30 ans après, que ce soit dans des codir, des sessions de formations managers, ou même dans des présentations de consultants, nous retrouvions cette courbe de deuil appliqué au changement ? Pourquoi s’appuyer toujours sur cette linéarité et stabilité, en mettant de côté les dynamiques complexes des organisations modernes ?
Certes il y a des points communs entre un deuil et un changement que nous pouvons aisément comprendre : le changement lorsqu’il est imposé peut-être vécu comme une perte avec des réactions émotionnelles identiques, comme un sentiment de désorientation, une perte d’équilibre. De même, que ce soit dans le cas d’un deuil ou d’un changement organisationnel, les individus doivent s’adapter progressivement à une nouvelle réalité qui implique un état d’avant à un état d’après. Peut être également, pouvons-nous retrouver des états émotionnels similaires, tel que la résistance, la colère, la tristesse ou la recherche de sens. Voilà grossièrement les points communs que nous pouvons trouver. Nous laissons libre à chacun de s’y retrouver…ou pas.
Une illusion de maîtrise
En revanche cette assimilation permet sans nul doute de nous donner l’illusion de comprendre et d’anticiper. Les personnes qui accompagnent ou qui expliquent comment se vivent les changements, ont ainsi l’impression d’avoir LA clé pour comprendre les salariés qui les vivent. Ce modèle offre la possibilité de se rassurer et parfois de rassurer l’autre, quant à la prédictibilité de ce qu’il va se passer et anticiper ainsi les réactions. La dédramatisation de ce processus d’intégration permet de normaliser les réactions, et de réduire ainsi l’isolement et la confusion que certains peuvent ressentir. En reconnaissant que l’acceptation est la dernière étape tant dans le deuil que dans le changement, les individus peuvent être encouragés à travailler vers cette acceptation, comme but à atteindre, comme une finalité d’un processus.
Un modèle qui montre ses limites
Bien que cette comparaison soit utile, elle a ses limites. Même si elle fournit un cadre utile qui permet de naviguer (ou de donner l’illusion de naviguer) plus efficacement dans les transitions, les changements ne sont pas vécus de manière aussi intense que le deuil d’une personne chère, et certaines personnes peuvent réagir de manière plus rapide ou plus positive au changement. Il n’y a donc pas de linéarité ni d’universalité à cela. Comme le note Deborah D. Kessler ou encore George Bonanno dans son livre « The Other Side of Sadness » publiés en 2009, les réactions au changement ne suivent pas toujours cette séquence exacte et peuvent varier d’une personne à l’autre.
De plus, en se centrant sur les réactions individuelles sans tenir compte des aspects systémiques du changement, nous omettons qu’une organisation est un système complexe où différents éléments sont interconnectés, s’influencent mutuellement et donc de fait, influencent le processus de changement.
Le modèle SCARF : une alternative basée sur les neurosciences
S’il n’existe pas un modèle qui viendrait prendre en compte non seulement les processus internes, mais aussi les interactions avec l’environnement externe, où les facteurs, tels que la culture, la personnalité, le contexte organisationnel, un modèle nous aide au quotidien : le modèle SCARF de David Rock.
Pionnier dans l’application des neurosciences au leadership et à la gestion du changement, Rock développe le modèle SCARF dans son livre « Your Brain at Work », publié en 2009 :
S pour Status/Statut,
C pour Certainty/Certitude,
A pour Autonomy/Autonomie,
R pour Relatedness/Lien,
F pour Fairness/Equité).
Il pose l’hypothèse que ces cinq besoins humains fondamentaux organisationnel influencent la réponse sociale des individus au travail et qu’y répondre, permettrait de minimiser les résistances aux changements et d’en faciliter l’acceptation. Par exemple, si le changement implique une redistribution des rôles, certains salariés pourraient percevoir une perte de statut ou une diminution de leur autonomie. Le modèle permet ainsi de prévoir les zones de résistance en fonction des impacts potentiels sur chaque domaine SCARF.
Un modèle prometteur mais encore en développement
Certes ce modèle reste imparfait puisqu’il ne prend pas en compte tous les aspects systémiques qui influencent les comportements humains (notamment l’influence culturelle). La neuroscience appliquée aux comportements organisationnels reste encore un domaine en développement, et certaines hypothèses pourront être révisées ou nuancées par de futures recherches.
SOURCES :
On Death and Dying. 1969 Kübler-Ross
Your Brain at Work, 2009, David Rock
The Other Side of Sadness, 2009, George Bonanno
Article rédigé par Jeanne Chevallier, Consultante Manager Senior chez Stimulus